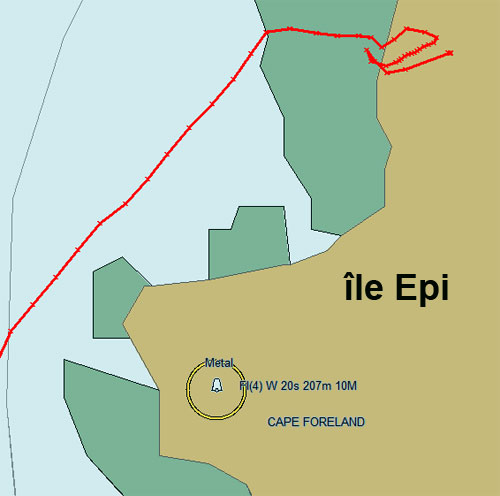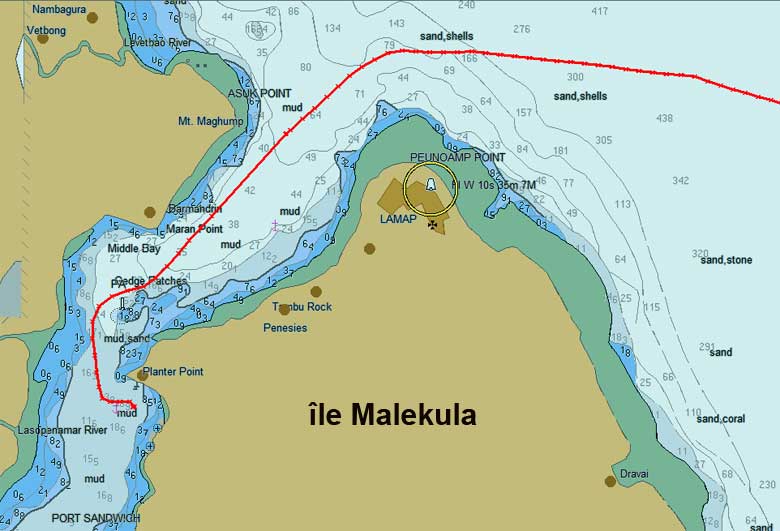|
Cahier N° 115 |
 |
De Efate nous avions
planifié de rejoindre directement Ambrym et de trouver un mouillage
temporaire après avoir contourné Dip Point, à l'extrémité SW de
l'île . Ca faisait une petite
navigation d'environ 85 milles...
Escale à
Epi: (Suite
de l'introduction)
 |
|
Le vent en a décidé autrement. Il
n'a pas été très fort de toute la journée et nous
n'avons pas parcouru plus des deux tiers du chemin, la
nuit arrivant. Le ciel s'obscurcit alors de lourds
nuages d'orage. Ca ne promet pas une nuit en mer très
agréable. Nous sommes en train de chercher une
alternative sur la carte quand arrive un dauphin très
vif et démonstratif. Il se met à notre étrave et prend
délibérément la direction du cap Foreland. Nous avions
repéré ce cap sur la carte électronique mais celle ci
n'est absolument pas assez précise et bien calée pour
permettre un |
| |
|
atterrissage facile de nuit. |
 |
|
Le dauphin nous accompagne
toujours. Quand
nous faisons mine de nous éloigner de la cote il revient
à notre étrave, quand nous pointons sur le cap il fait
des bonds en l'air tout joyeux. On a vraiment
l'impression qu'il nous dit
"- C'est la bas qu'il faut aller".
Nous y sommes allés. Nous nous sommes
avancés tout doucement, les yeux rivés sur le récif à
peine visible et
sur le sondeur. Nous ne trouvons pas de profondeur
"mouillable". Nous faisons demi tour. Le dauphin
manifeste . Nous retournons et jetons finalement
l'ancre. Notre ami s'en va alors. |
| |
|
|
 |
|
Vous allez dire :
Effet du hasard...
Bien
évidemment... Récit romantique sorti de mon
imagination!
Surement un peu...
Mais nous avons les photos du
dauphin qui était bien réel et quand nous
repartons de bonne heure le lendemain matin, nous
découvrons la silhouette du cap Foreland qui représente un dauphin. Ca on ne le rêve pas... Et puis l'ordinateur
que nous avions laissé allumé durant les manœuvres, il a
bien enregistré la trace de nos hésitations...
Alors... |
| |
|
|
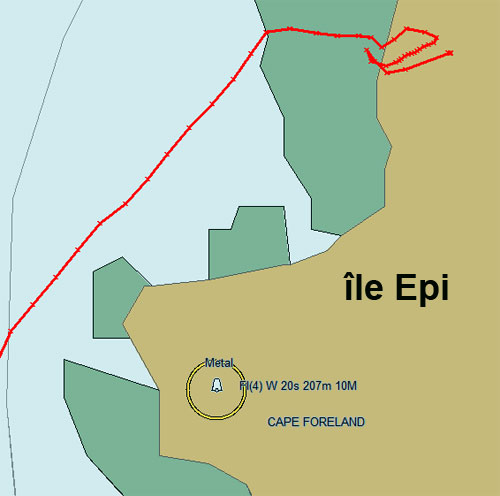 |
|
Télécharger nos traces de navigation: Télécharger les fichiers "Traces" qui peuvent
ensuite être utilisés avec un logiciel comme Open CPN.
(Explications
sur le téléchargement à la fin de la page "carte du Vanuatu")
Cliquez ici pour
charger la trace permettant de rentrer dans
la baie au Nord du cap Foreland. Vous voyez qu'il ne
faut pas se fier à la carte car selon elle nous avons
mouillé à l'intérieur des terres.
Nous étions sur un fond de sable vaseux à une profondeur
de 12 à 14 mètres, à la position: 16°40,86'S -
168°07,47' E Tenue ???
Télécharger aussi les deux fichiers
suivants qui correspondent à la carte ci-dessous à
Malekula:
Entrée de Port Sandwich
Intérieur de Port Sandwich |
| |
|
|
Découverte:
L'île de Malekula
(ou Mallicolo):
Informations
nautiques:
Nous étions repartis
pour bien contourner cette fois Dip Point et longer la cote Nord
d'Ambrym. Nous étions encore à une bonne quinzaine de milles
du cap, quand un gros grain nous tombe dessus en moins de temps
qu'il n'a fallu pour que nous le voyons arriver. 35 nœuds de vent
établi pendant au moins 45 minutes.
Affalement complet de la grand voile en catastrophe car on ne
sait pas sur le moment si ca va monter encore et enroulement
du génois lourd à la moitié de sa surface... Et on abat pour ne pas
se faire coucher par les surventes furieuses. Jean-Baptiste fait les
manœuvres rapidement pendant qu'Anik débranche le pilote pour
prendre la barre elle même d'une main ferme.
 |
|

ZiiiiiiP c'est à
ce moment là que le moulinet se met à filer... Geneviève se
débrouille toute seule et ramène un beau barracuda. |
Devant nous il n'y a plus rien. Tout est gris sous la pluie
battante. Pourtant nous savons qu'il y a l'île de Malekula avec
de nombreuses baies très abritées.
Pendant que nous avons encore de l'eau à courir Jean-Baptiste
descend à la table à carte pour évaluer le meilleur point
d'atterrissage.
La encore, c'est la
météo qui a décidé pour nous de notre escale suivante. Ca ne sera pas
sur l'île d'Ambrym mais à port
Sandwich sur l'île de Malekula qui doit être relativement facile d'entrée et qui offre un
réel abri tout temps si par hasard ce qui vient de nous tomber
dessus devait durer, voir empirer.
Le temps n'a
pas empiré et l'atterrissage sur la
profonde baie ne pose pas de problème particulier sauf à réussir à
repérer l'entrée quand il fait un temps chargé comme celui que nous
avions. Il faut surtout bien arrondir la pointe Peunoamp car le
platier, invisible la plupart du temps, sauf à marée très basse,
s'étend à au moins 1/4 de mille vers le Nord. (Voir plus bas la
photo du platier prise du village de Lamap).

Dans la première
partie de la baie, les deux rives sont franches et la partie du
milieu est très profonde. Ensuite, il y a un petit zigzag à faire
pour éviter un haut fond et passer dans la partie Sud. Nous avons
trouvé un mouillage calme comme sur un lac, au Sud de la pointe
Planter. Fond de vase de bonne tenue (nous étions bien à l'abri du
vent) dans une profondeur de 6 mètres. Position: 6°26,376' S -
167°47,02' E.
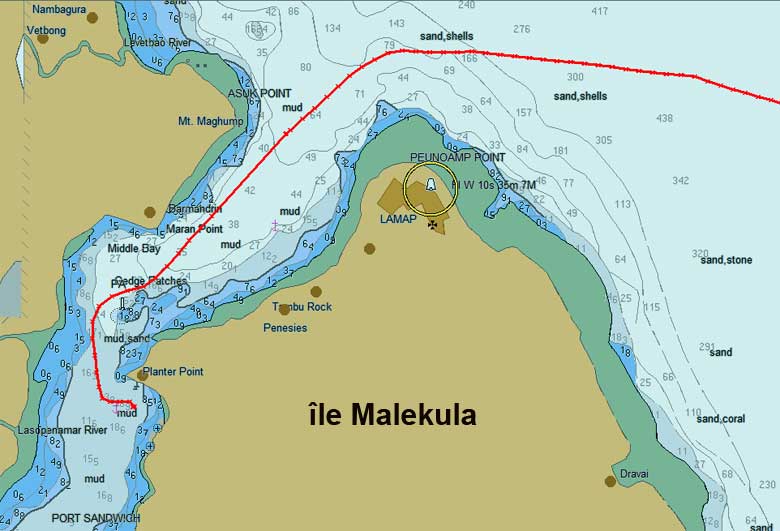

Nous
avons trouvé un mouillage calme comme sur un lac, au Sud de la
pointe Planter.
Mais il est prudent de ne pas se baigner, toute la baie naturelle
est réputée pour ses requins.
L'île de Malekula
Nous voici donc sur l'île de Malekula sans
vraiment l'avoir décidé. C'est la deuxième île de l'archipel par sa
superficie de 2024 km². 94 km de long et 44 km dans sa partie la
plus large. Elle est aussi la première île exportatrice de coprah
(pulpe de coco séchée) et de cacao La cote est très découpée
et offre de nombreux mouillages dont certains sont très surs comme
ici à port Sandwich qui pourrait éventuellement être un trou à
cyclone en fond de baie.
Le Mont Penot culmine à 879 mètres. L'ile est
dans l'ensemble assez élevée, découpée de vallées profondes. La
pénétration de l'île est difficile et l'intérieur est presque un
désert humain aujourd'hui. Traditionnellement on y trouve deux
groupes qui ont une langue et une culture différentes. On les
appelle les big nambas au Nord sur les hauts plateaux, et les small
nanbas dans les montagnes du Sud. Leur nom leur a été donné en
fonction de la taille de leur étui pénien (le nambas) qu'ils portent
encore aujourd'hui. Cet étui est fabriqué avec une feuille de
pandanus, de burao ou de bananier pour les plus démonstratifs...
Les big nambas avaient une telle réputation
que les explorateurs ne s'approchaient que rarement de leur
territoire. Le cannibalisme a même fait fuir les quelques colons qui
avaient monté des plantations près de la cote. Il y avaient de
nombreuses guerres entre les tribus. Un rien pouvait la déclencher.
Elle s'arrêtait après avoir tué 3 ou 4 hommes. La cérémonie
commençait alors et se terminait par le repas de leur victime.
On se rassure en se disant que c'est de l'histoire ancienne mais en
fait pas tant que cela... aux Marquises nous avions été invité par
une femme qui nous raconta que sa grand mère avait gouté du dernier
gendarme qu'ils ont mangé vers 1920.
Chez les big nambas il était naturel pour un
chef de village d'avoir plusieurs femmes et mêmes quelques jeunes
hommes pour assouvir ses désirs. Chez les small nambas par contre
les hommes du village dormaient dans une maison commune le "amel",
les femmes et les enfants dormaient dans une autre maison... Y
aurait-il lien de cause a effet sur la longueur des nambas ?
Pour compenser, les small nambas pratiquaient l'élongation du crane
sur les jeunes garçons.
 |
(*) |
Sitôt Banik ancré, nous descendons l'annexe
pour nous rendre à terre. C'est curieux, il y a très peu de plage, pas
une seule vague, tout de suite de l'herbe, des pâturages avec
des vaches et juste derrière, des plantations de cocotiers. Nous
avons l'impression d'être à la campagne au bord d'un étang plutôt
que sur une île. Le Vanuatu offre vraiment une multitude de paysages
et d'ambiances.
On fait un feu pour griller quelques darnes du barracuda.. . On a
déjà oublié qu'il y a quelques heures nous nous faisions brasser en haute mer. |
| |
|
|
 |
|
Gilbert qui habite dans une maison du hameau
juste à coté, vient nous rendre visite et s'assoit avec nous près du
feu. Il propose d'échanger
quelques fruits et légumes contre quelques bricoles que nous
avons à bord.
Nous avons souvent pratiqué ce
genre d'échange dans les îles du Vanuatu. Ils ont des
fruits en abondance et sont toujours preneurs de t-shirt
(surtout s'il y a une grosse pub dessus, un
t-shirt tout blanc est moins joli) Ils apprécient aussi
les casquettes ou le lait en poudre, un peu d'essence
pour le hors bord ou une bougie neuve... Il y a toujours
quelque chose qui les dépanne. |
Sur la route de Lamap
Le lendemain nous décidons de marcher jusqu'au
village de Lamap.
Tout au long du chemin nous rencontrons de nombreuses personnes
toutes charmantes et heureuses de discuter un moment avec nous. Du
coup nous avons mis près de deux heures pour y aller alors que cela
se fait tranquillement en 45 minutes.
Lamap est aujourd'hui un village paisible mais
au temps du condominium c'était la troisième ville importante de
l'archipel. On y trouve une école, une poste et quelques boutiques.

Les petites maisons en parpaings et tôles
ondulées sont rustiques mais propres et les jardins fleuris. Mais ce
qui dominent tout, ce sont les innombrables cocotiers bien alignés
dans d'énormes plantation. On comprend bien qu'ils puissent
produire tant de coprah.

| Toutes les minutes,
des dizaines de cocos tombent toutes seules des arbres.
Il suffit de les ramasser pour assurer les revenus.
Ce qui est le plus dur dans la nature c'est de trouver
les cocos qui viennent de tomber. En général elles sont
vite cachées par l'épaisse végétation au sol. Si on ne
les ramasse pas elles sèchent ou bien se mettent à germer
et sont perdues pour la pulpe. L'idéal est d'avoir un
sol totalement dépourvu de végétation comme dans cette
plantation. On voit tout de suite les cocos qui sont
tombées dans la journée et on les récupère rapidement
avec des brouettes. Des chemins sinueux sont tracées
dans les plus grands espaces entre les arbres, ce qui
permet de circuler sans le risque de recevoir une
coco qui tombe du ciel. Mais c'est du boulot
d'entretenir le sol de tout ce terrain alors ils ont
trouvé la combine: Ils clôturent la plantation
comme un pâturage chez nous et y mettent des vaches et
des cochons. Ca fournit donc la viande en plus..
Organisation géniale de production maximum avec le
minimum de travail.
"Ils ne m'ont pas appris à suivre les petits chemins
sinueux à moi... Ils s'en fichent que je sois assommée
par une coco." |
|
 |

Au Nord du village de
Lamap nous arrivons à la pointe Peunoamp que nous avions contournée
en navigation hier. C'est marée basse maintenant et l'on voit bien
le grand platier qui déborde la pointe à près de 500 mètres. Des
pécheurs à pied ramassent des coquillages et des crustacés.
|
Nous voici sur la route du retour vers Banik. Nous
commençons à avoir faim et on se promet de ne pas mettre
2 heures pour rentrer. Mais en chemin, nous avons fait la connaissance d'Arnaud qui est le sécheur des fèves de cacao dans le village de Lamap.
Son four très rustique, placé au bord de la route, avait
attiré notre curiosité et nous nous étions arrêtés pour
le prendre en photo. Arnaud était alors apparu. Il ne
s'est pas fait prier pour répondre à nos questions et
nous donner toutes les explications sur la manière
dont il procède :
Un curieux
bâtiment avec de la fumée qui sort de l'arrière attire
notre curiosité. |
|
 |
| |
|
|
| Arnaud ne
s'est pas fait prier pour répondre à nos questions |
(*) |
 |
| |
|
|
| Arnaud
rachète les fèves aux différents propriétaires de
cacaotiers autour du village. Les
cacaotiers que l’on a vus ne sont pas de très grands arbres et les
gousses contenant les fèves étaient encore vertes. Il faut attendre
qu’elles soient bien jaunes pour les cueillir. Arnaud achète le kilo
de fève fraiches et déjà décortiquées de la gousse 60 vatus
C'est-à-dire 1/2 €. |
|
 |
| |
|
|
| Au début
du processus, il place les fèves dans un bac en bois et
il les laisse 3 jours. Elles commencent alors à perdre
leur eau. Ensuite il les change de bac ce qui permet
d’aérer un peu le tas et elles y resteront encore 3
jours ainsi que dans le troisième bac. Le fait de les
changer de bac ça les remue un peu, c’est important.
Au bout de 9
jours dans les bacs, il complète le séchage en
étalant les fèves au dessus du four. |
|
 |
| |
|
|
| Le four:
Le
tamis qui reçoit les fèves est placé au dessus d’un
tunnel fait de plusieurs futs de 200 litres découpés et mis bout à
bout.
De longues branches sont enfilées dans les futs et se
consument en dégageant une bonne chaleur.
Le tunnel, qui est la source de chaleur est enveloppé de
tôles ondulées jusqu’au tamis. L'air chaud ne peut s'échapper qu'à
travers la
grille en séchant les fèves. |
|
 |
| |
|
|
| Le
tirage est assuré par une rustique cheminée placée au
bout du tunnel. |
|
 |
| |
|
|
| Le jeune
apprenti qui aide Arnaud retournera les fèves tous les ¼
d’heure pendant les 48 heures qu’elles passeront à la
chauffe.
Attention il
ne faut pas griller les fèves, juste les sécher.
|
|
 |

Arnaud revendra 120
vatu (1€) le kilo de fèves séchées qui seront expédiées sur l’ile
voisine d’Espiritu Santo. C’est là bas qu’ils récupèrent la
production de tous les petits récoltants des îles du milieu de
l’archipel. Les jours de grand soleil, les négociants en profitent
pour sécher une dernière fois les fèves au grand air. Cela leur
permet de faire un ultime tri et aussi ca leur enlève un peu des
odeurs de fumée. Ensuite les fèves sont vendues en Australie où
elles seront transformées en chocolat.

Textes et photos :
|
 |
|
 |
| |
Anik
Delannoy |
|
Jean-Baptiste Delannoy |
| Les photos marquées par
(*) sont de: |
 |
|
Geneviève a
été équipière sur Banik en 2010 de Nouméa en Nouvelle
Calédonie jusque Darwin en Australie |
| |
Geneviève Liquière |
|
|
|